Il était une fois un havre dans la forêt québécoise
La vie en nature m’a toujours attiré. Déjà, lorsque je résidais encore en France, après avoir vécu à Paris, à Bordeaux et à Nancy, je ressentais l’appel de la campagne, ou devrais-je dire de la vie rurale. Ainsi voulais-je me retirer, du moins en partie, du monde citadin dont j’étais sans doute rassasié ; m’éloigner des nuisances humaines dont l’omniprésence m’oppressait.
En quittant mon pays natal pour immigrer au Canada, et m’installer au Québec il y a maintenant six ans, j’ai dû revoir mes priorités, privilégiant ainsi la découverte et l’adaptation dans cette métropole fantasque qu’est Montréal. Ce qui fut une sage décision en vertu du réseau facilement établi et des innombrables opportunités, tant professionnelles que relationnelles. Ceci étant, chaque excursion dans des contrées éloignées, aussi bien aux confins de la péninsule gaspésienne que dans les territoires naturels explorés à l’étranger, a toujours suscité en moi l’inéluctable attrait d’un ailleurs fantasmé et forgé par le désir d’être soi, sans artifices, face aux montagnes, à la forêt ou à la mer. Se confondre avec la nature et s’y épanouir.
Voilà la raison pour laquelle j’ai souhaité quitter Montréal, accompagné de celle qui partage ma vie, pour enfin sauter le pas, et partir vivre en chalet, une demeure isolée dans une forêt semblable aux décors dont les cartes postales du Canada regorgent. Pourtant, si un tel projet se concrétisait enfin, la réalité sur place allait être plus brutale qu’idéale.
Le plaisir de la contemplation et le mal de la solitude
Je débarque dans le petit paradis de plein air que promet la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, située dans la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, au creux de la vallée de la rivière Montmorency, au début de l’automne. Pour la première fois, je peux profiter des couleurs saisonnières, si éphémères au Québec, avec abondance et proximité. Les grandes fenêtres du salon m’offrent un spectacle à savourer sans modération ; le paysage délivre ses couleurs flamboyantes, bigarrées de rouge, d’orange et de jaune. Au fil des jours, les arbres par milliers se muent en une œuvre mélancolique et mystique.
Sans crier gare, l’hiver frappe à la porte, et s’installe comme un gigantesque drap blanc pour les six mois à venir. Les premières chutes de neige m’éblouissent. À la différence de Montréal, la blancheur immaculée qui recouvre l’entièreté du jardin, ainsi que la majeure partie de la flore des alentours, ne disparaît pas. Au contraire, elle s’intensifie de mois en mois. Cette neige exubérante devient ce monde nouveau auquel je ne suis peut-être pas si bien préparé. Si les sorties en raquettes, les randonnées pédestres improvisées, l’accès à la poudreuse ont rarement été aussi féériques, le quotidien quant à lui est enraillé par des contraintes et des coûts indésirés. Entre les déneigements incessants, la dépendance à un véhicule à moteur et la consommation excessive de bois et d’énergie pour se chauffer, il faut bien admettre qu’un tel mode de vie se paye, inévitablement, avec de l’argent et du temps. Par ailleurs, j’abhorre la simple idée de destiner mes fins de semaine à la gestion de rénovations, mêmes mineures.
Les premiers mois, le silence est réparateur. Profondément apaisant. Mais doucement, un mal-être s’infiltre dans notre foyer prétendument idyllique, sur le papier. L’isolement, ou cette sensation d’être loin de tout, et de tous, mais surtout le constat de subir l’ennui, malgré la gestion d’une entreprise, une passion pour les sports de plein air, et la volonté d’écrire – activité que je voudrais plus féconde dans un environnement y étant théoriquement propice –, finit par avoir raison de mes motivations. Sans que j’aie le temps d’en prendre conscience, à l’image de l’arbre centenaire trônant au milieu du terrain, je suis à mon tour dépouillé de mon feuillage, et de ma vivacité. L’hiver, rude et sans issue dans l’immédiat, endosse le rôle du protagoniste fascinant et insolent dans ce chapitre. Bien plus qu’une toile de fond, il fait avancer l’intrigue de cette vie en chalet, à tel point que ce n’est pas moi qui l’embrasse, mais plutôt lui qui me phagocyte. J’épouse ainsi son rythme, respirant au diapason avec la nature en sommeil. D’une certaine manière j’hiverne à contrecœur, car ma vie semble être ailleurs. Dès lors, chaque occasion est bonne à saisir pour conduire jusqu’à Montréal, et y retrouver la vie foisonnante, tout comme les amitiés si chères à mon cœur.
Se réconcilier avec la vie urbaine
Le printemps balbutiant, à mon retour d’un voyage en Afrique, il me faut prendre une décision déterminante. Cette dernière ne se fait pas attendre ; après de courtes réflexions, il nous apparaît comme évident que l’option la plus cohérente serait de nous séparer de cette maison, et de revenir vivre en ville. Non pas qu’il soit si fastidieux de s’accoutumer à la petite ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, mais ce « chez nous » n’en est visiblement pas un, pas celui tant espéré. Pour un immigré originaire de France tel que moi, habitué aux contextes urbains, et cela quelle que soit la variété des voyages et autres défis effectués en milieux lointains, la ruralité du Québec revêt un visage plus sévère qu’on ne le pense. L’absence de transport collectif, le manque (relatif, car cela dépend du point de départ) de diversité sociale, ethnique et culturelle, et les responsabilités additionnelles qui accompagnent l’entretien d’une propriété en bois dans des conditions climatiques aussi rigoureuses m’invitent à me questionner sur la pertinence de mes choix. À cela, il faut ajouter la distance avec la famille qui pèse sans surprise sur la balance. Vivre à plusieurs milliers de kilomètres de son pays natal peut parfois être une épreuve ; se marginaliser géographiquement sur un autre continent en est une autre, et de taille. Mais plus important encore, l’arrivée prochaine d’un premier enfant nous encourage à rejoindre la « civilisation » (façon de parler).
Au cœur de l’été, soit près d’un an après avoir radicalement changé d’environnement de vie, nous revenons sur nos pas. Je n’ai pas pour habitude de faire machine arrière ; au contraire, j’avance et prends continuellement des risques mesurés. La routine me désole, et comme toujours choisir revient à renoncer. Je ne considère donc pas qu’un tel dénouement, résultant de cette expérience en région brève mais assumée, soit un échec. Sans vouloir enfoncer de portes ouvertes, mon immersion dans la forêt québécoise aura été un apprentissage fort utile pour appréhender l’avenir. Derrière le caractère romantique d’un charmant tableau, rien ne sert de nier la réalité, s’il en est une qui dénote avec l’ambition initiale. Oui, la vie urbaine a bien souvent de quoi irriter, épuiser, étouffer, mais elle reste un puits incontestable d’opportunités et de possibles.
Je ne dis pas que je ne renouvellerai pas l’expérience plus tard, ailleurs, éventuellement dans un autre pays. Mais pour le moment, j’apprends à me satisfaire d’être là où je suis, dans l’instant présent. Et de profiter de la présence des gens qui m’entourent. Si j’ai parfois tendance à vivre dans ma grotte, autrement dit qu’il m’arrive de tendre vers une solitude volontaire, ne serait-ce que pour trouver l’inspiration, stimuler la créativité essentielle à certaines de mes activités, je sais aujourd’hui que je reste attaché aux relations tissées avec les hommes et les femmes qui m’entourent.
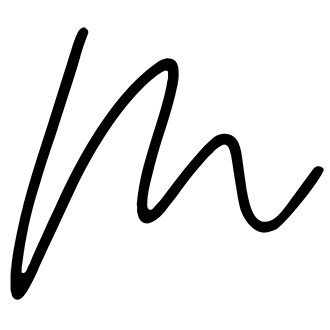

Laisser un commentaire