Comme je n’avais encore jamais exploré cette partie du Québec, je me suis laissé tenter par une mini-expédition : une traversée hivernale du Mont Gosford. Accessible et sans grande difficulté — à condition de disposer d’une bonne condition physique, et à l’exception de quelques segments verglacés à cette période de l’année —, cette randonnée de plusieurs dizaines de kilomètres peut s’effectuer à un rythme modéré. Afin de profiter au mieux de cette expérience, je l’ai donc réalisée en trois jours, accompagné de ma partenaire de marche, sans me priver des deux nuitées confortables (une fois n’est pas coutume) dans des chalets rustiques situés le long du parcours.
Avec près de 1200 mètres d’altitude, le mont Gosford est le 7e plus haut sommet du Québec. À son pic, la vue panoramique 360° révèle les territoires sauvages et montagneux du Maine et du New Hampshire aux États-Unis, ainsi que les montagnes frontalières de la région de Lac-Mégantic.
À l’assaut des sentiers enneigés
Nous longeons la rivière Arnold, emmitouflés dans nos vêtements d’hiver, une paire de raquettes accrochée sur le sac à dos, crampons aux chaussures, sous les flocons de neige. De la neige, il n’y en a pas autant que là d’où je viens, et autant dire que la fonte est amorcée. Au moins, les températures sont moins extrêmes que ce qu’on a pu connaître ces derniers mois. Ce qui me surprend le plus, c’est le silence qui règne en maître et la sérénité que les lieux procurent. Au détour d’un arbre, il arrive qu’un écureuil fasse la démonstration brève de son agilité devant nos yeux trop habitués à en voir.
À mi-chemin, l’ascension nous plonge dans le ventre d’une tempête de neige interdisant toute percée du soleil. Le sommet n’est pas au programme du jour puisque nous devons bifurquer pour nous diriger vers le refuge Clearwater où nous attendent la chaleur d’un poêle et le réconfort d’un abri jusqu’au lendemain. Si je devais mettre trois mots sur cette excursion en plein air, je dirais : nature, littérature et solitude. Le chalet dans lequel nous nous sommes arrêtés est relativement bien isolé, à tel point que la chaleur produite par la combustion du bois dans le poêle me donne presque envie d’embrasser le froid du dehors. Après un bon repas, et un peu de lecture choisie pour l’occasion (Journal d’un bibliothécaire de survie de Charles Sagalane, ou encore Une vie à coucher dehors de Sylvain Tesson), Morphée nous tend ses bras tentaculaires et nous emporte dans le doux berceau de la nuit. Une nuit noire et venteuse ; les rafales bien que contenues ne cessent de lécher le toit du refuge. Quand les bourrasques les plus puissantes viennent tester la résistance de la tôle, le craquement des planches de bois ébranle nos certitudes autant qu’il affirme le caractère brut des lieux. Dans cette agitation des éléments, l’esprit se distrait, puis finit par s’abandonner au tumulte innocent des rêves.

Ode à la candeur des cimes
Au petit matin, après un brin de toilette — soyons honnêtes, un coup de neige sur le visage — et quelques poignées d’avoine en guise de petit déjeuner, il nous faut quitter ce havre d’une nuit, pour retrouver la poésie sauvage des paysages du Québec. Sans embûches, nous parvenons au sommet du Mont Gosford, après avoir traversé un décor féérique digne du Monde de Narnia. Au fur et à mesure de l’ascension, les arbres se vêtissent d’un manteau blanc, dont l’épaisseur témoigne de l’altitude. Une fois que nous sommes arrivés tout en haut, le ciel couvert qui nous refuse toujours les lumières d’or du soleil nous dévoile ses traits mélancoliques. Devant nous, se dresse la chaîne des Appalaches, et les courbes terrestres que forme le dénivelé suffisent à nourrir les songes qui m’habitent. C’est un peu comme si la vue des montagnes suscitait l’appel de l’aventure, dans un cœur vagabond. À défaut de contempler l’océan et de penser au large, ce sont les cimes qui peignent un horizon de méditation. La redescente est suivie d’un tronçon aux contours moins lyriques. La végétation change, et la forêt abondante laisse progressivement place aux étendues désolées d’une érablière. Sous l’effet du soleil et du vent, le sol exposé s’est transformé en zone glissante, de quoi finir quelques pentes abruptes sur les fesses. Avec hâte, nous progressons ainsi vers notre destination. Le refuge Morin.
La routine est bien rodée : nous changeons de tenue, suspendons nos vêtements humides ou mouillés sur une corde au-dessus du poêle ; après quoi nous dégustons un repas lyophilisé ; enfin nous finissons enroulés dans nos duvets en plein après-midi. L’heure est au délice velouté d’une sieste restauratrice.
L’esprit ravivé, nous optons pour une marche en forêt le long du ruisseau Morin. Les traces de nos pas côtoient des empreintes qui semblent être celles d’un coyote. Nous les suivons un temps, jusqu’à ce qu’elles dévient vers les ombres mystérieuses d’une flore hors sentier. Parvenus à l’abri trois murs mentionné sur la carte, nous marquons un arrêt, causant de choses et d’autres. C’est sans doute le genre de moment que je préfère lorsque je déambule en nature : ces périodes d’introspection, là où les évidences se dénudent, où les prises de conscience opèrent spontanément. Ma récente initiation aux pratiques chamaniques m’a inculqué un enseignement capital dans l’appréhension des relations humaines : déchiffrer l’homme ou la femme par le prisme de ses blessures passées. Combien sommes-nous à naviguer sur des fleuves impassibles, camouflant nos cicatrices pour nous prémunir de l’adversité ? Mais quoi que nous fassions, nos failles subsistent. À moins de s’y engouffrer, munis du bon remède. Plus nous conversons, plus je me rends compte à quel point jusqu’ici ma vie a été riche, et comblée d’aventures. Je ne réalise pas toujours la teneur de mes accomplissements. Et pourtant, qu’ils soient ordinaires, ou bien hors de l’ordinaire, je ne compte plus les exaltations auxquelles je peux me raccrocher tant celles-ci peuplent ma mémoire. Dans la victoire comme dans la défaite, et dans l’infortune comme dans la joie, j’ai eu le privilège de goûter à la beauté de notre monde. À ses cris d’allégresse.






L’éternelle médecine des Hommes
À travers la fenêtre de notre refuge, nous observons le coucher de soleil embraser la paroi d’une montagne. Le bois crépite dans le poêle, quelques gorgées d’une bière de microbrasserie emplissent ma gorge d’une amertume suave. La pièce marie des odeurs de charpente à la chaleur diffuse. Ce soir, nous occupons cette alcôve intemporelle et solitaire. Nul ne se dérobe à la nuit. Sa noirceur abreuve l’espace, et c’est à la lampe frontale que je termine les dernières pages de mon livre. J’y découvre une merveilleuse citation d’un auteur que je tiens en haute estime depuis toujours, Henri David Thoreau :
« Le paysage intérieur est vaste et beau, et c’est celui dont les pensées sont les plus profondes qui entreprend les plus lointains voyages. »
À la naissance du jour, l’aube nous gâte de ses plus belles lumières. Le ciel est d’un bleu océanique, deux mésanges piaillent sur les branches d’un arbre prêt à renouveler sa parure de feuilles. Avant de repartir et de faire un détour par le sommet du Mont Gosford — avec une telle météo, il est impensable de ne pas y retourner — je pratique des exercices de respiration issus de la méthode Wim Hof : mon rituel matinal.
Le sommet n’a pas bougé, mais le paysage s’est transformé. Entre la scène saturnienne du jour précédent, résurgence d’une œuvre romantique allemande, et l’explosion ensoleillée que nous sommes en train de savourer, le contraste est à son apothéose. Le printemps, parti pour un long périple, annonce son arrivée imminente. La descente est toujours aussi glissante, et la neige endurcie. Les crampons sont requis. Sur le chemin du retour, nous croisons pour la première fois des randonneurs. Décidément, je m’étais habitué à la solitude. Les bonnes choses ont une fin, et comme toute expérience digne de ce nom suppose d’aboutir à une moralité, un précepte ou un apprentissage, mon histoire se conclut au bord de la rivière Arnold que nous retrouvons pour achever notre traversée.
Au bruit de l’eau qui se déverse continuellement, j’entends la vie couler. Rien ne peut en arrêter le flot. Ma médecine n’a rien de spectaculaire, ni d’artificiel. Peut-être est-elle universelle. Elle réside dans cet indivisible duo : la nature et le mouvement.
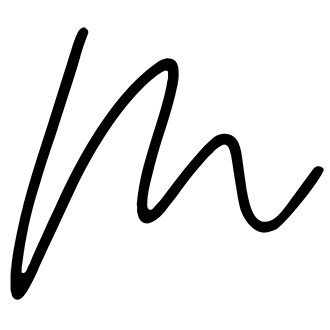

Laisser un commentaire