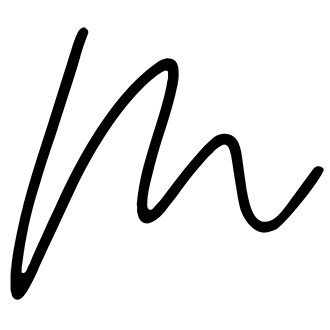Du goût du ciel, je ne récolte que la saveur du vide
On ne peut pas toujours contrôler tous les paramètres, ni même garantir l’issue d’une tentative, aussi ambitieuse et orchestrée soit-elle. Même au meilleur de sa forme, prêt à affronter les cimes, à braver les crêtes, à flirter avec le céleste sur les sommets les plus périlleux, une simple dose de malchance peut encore s’infiltrer dans l’engrenage du triomphe et faire dérailler la machine. Ce devait être une porte de sortie, mon dernier ultra, un ultime soupir sur les sentiers pour les temps à venir, car pour des raisons personnelles, j’avais pris la résolution d’explorer d’autres horizons. Je pensais avoir trouvé, au fil des ans, ce que j’étais venu chercher dans l’ultra-trail, soit dans l’épreuve des courses de longue distance ; une discipline qui dans mon cœur aura connu son âge d’or. Avec un entraînement que je pourrais qualifier d’expérimental cette année, combinant de la course sur route et du travail spécifique en dénivelé, des séances de crossfit et de mobilité, je me suis pris au jeu de la performance. Puisant ce qui me semblait bénéfique dans une pratique diversifiée, allant du marathon au trail running, en passant par les entraînements croisés et les workouts par intervalles à haute intensité, j’ai misé sur la qualité, et minimisé le volume sans remords. Au quotidien, je ne suis pas un « borneur ». En effet, pour préparer un ultra, même d’envergure, je ne dépasse que très rarement les 30km de course dans une sortie, et à vrai dire je ne me suis jamais senti aussi solide et efficient dans ma pratique sportive qu’en cette saison. Je m’étais ainsi fait la promesse d’aller côtoyer les étoiles dans le Haut Atlas marocain, à l’occasion d’un défi à la hauteur de mes ardeurs : l’Ultra Trail Atlas Toubkal (UTAT). Pas moins de 105km et 8000m de D+ au programme.
Sur le toit de l’Afrique du Nord
L’UTAT incluant des cols en haute altitude, c’est-à-dire à plus de 3000m, j’ai opté pour l’ascension du plus haut sommet de l’Atlas — le djebel Toubkal situé à 4167m d’altitude — dans le but de m’acclimater à ce genre d’environnement, quelques jours en amont de la course. Après une nuit blanche à ne pas pouvoir fermer l’œil dans la tente au camp de base, nous partons à 4h du matin avec mon groupe à l’assaut de ce point culminant dans les cieux. En file indienne sous la voûte gorgée d’étoiles, nous gravissons à la force de nos jambes le terrain rude et rocailleux, frappés par les vents froids. La météo se montre toutefois clémente et nous invite à contempler la vue dans le théâtre de l’aube. Quand la nuit se dissipe, et l’obscurité s’évapore aux premières lueurs, ce sont les cimes qui se dévêtissent de leur parure aussi noire que ténébreuse. Voilà le sommet du Toubkal qui parade un peu plus haut, mais il nous reste un dernier effort à fournir pour y accéder. L’oxygène se raréfie, les températures chutent tandis que l’on s’expose aux bourrasques les plus glaciales, mais la lune s’est endormie, et le soleil, héroïque, s’exhibe fièrement ; tel un trésor suave, une joyau d’or ravivant nos corps transis. Quiconque connaît cet instant acclame la beauté de ses yeux, et devant un tel spectacle, ne peut qu’admettre l’inconsistance relative d’une vie, et sa fragilité. Si certains éprouvent les sommets pour satisfaire leur égo, d’autres, bien au contraire, apprennent à s’en libérer.
Dans la même journée, nous redescendons vers le village d’Ilmil, accompagnés de nos deux guides bienveillants. Déambulant parmi les mules et les Berbères, nous suivons le sentier tracé dans la montagne, guidés par le voyage incessant des eaux de l’Ourika. Lorsque nous débarquons enfin à Oukaïmeden, au Club Alpin Français (CAF), nous sommes pris en charge par l’organisation, et accueillis avec un couscous royal, suivi d’un massage des plus réconfortants.

La sagesse de l’abandon et la quête inachevée
Tomber malade juste avant le départ d’une course a toujours été ma plus grande crainte, encore plus lorsqu’il s’agit de l’événement phare destiné à ponctuer la saison. Tant de préparation, de concessions faites au nom d’un exploit sportif gravé sur le calendrier, nous rappelant sans cesse à l’ordre quand la motivation manque, ou que la tentation de se détourner de ses objectifs et de fuir ses responsabilités n’est jamais très loin. Réaliser l’ascension du Mont Toubkal fut sans doute une erreur du point de vue de l’optimisation de mon affûtage, pourtant je ne regrette en rien cette étape en vertu des rencontres amicales et des paysages hors du commun qui l’ont rendue inédite. Le voyage en avion, le décalage horaire, le manque de sommeil, les variations de température, l’altitude et l’effort physique ont-ils affaibli mon organisme au point de me rendre vulnérable au moindre virus ? Probablement. La gorge prise, la tête endolorie et les narines encombrées, je pressens alors la difficulté exponentielle de l’épreuve qui m’attend.
Le départ est donné à minuit, après un terrible orage qui menaçait de semer le chaos. Je tente de me convaincre qu’en courant, mon corps et mon mental me propulseront au-delà des inconforts, et de la douleur persistante. Bien qu’étant contre toute médication durant une course, je mise exceptionnellement sur le paracétamol dans l’espoir de soulager mes symptômes grippaux. Autant dire que je me serais bien passé de contracter une infection virale des voies respiratoires supérieures en cette période ; néanmoins je parviens à maintenir une bonne cadence dans la nuit apocalyptique traversée de part et d’autre par des brassées successives d’éclairs enragés. À peine ai-je franchi le premier col qu’un coup du sort semble vouloir condamner mon audace : un morceau de semelle se décroche d’une de mes chaussures (un défaut de fabrication qui tombe plutôt mal), je me retrouve alors à attaquer le sol sans crampons, directement sur l’amorti. Je pense instantanément à l’évidence de l’abandon, tant il me paraît surréaliste de continuer la course avec un tel handicap — une chaussure privée de son adhérence, et la crainte que celle-ci s’ouvre en deux au contact des pierres acérées sur le parcours. Pourtant, je persiste en strappant tant bien que mal ma godasse maudite de PC (point de contrôle) en PC. Évidemment, l’astuce a ses limites et la bande adhésive finit toujours par se déchirer, jusqu’à ce qu’un bénévole me dégote une petite sangle d’appoint pour consolider le tout. Le dispositif n’est pas idéal, ma circulation sanguine est coupée, mon pied est douloureux, la sangle quant à elle ne tient pas en place lors des montées, mais j’avance, kilomètre après kilomètre, avec d’autres coureurs dont Franck avec qui j’harmonise mon pace.
Au lever du jour, je suis toujours dans le top 10 de la course, en restant conservateur pour ne pas brûler précocement mes réserves d’énergie. Mais très vite, les comprimés de paracétamol ne font plus effet, mon pharynx est en feu, ma respiration entravée et pire encore, j’ai l’impression que mon crâne va exploser. Pour la première fois, je ne raisonne pas qu’en mon nom ; la seule pensée de ma paternité à venir agit comme un switch en mon for intérieur. Engagé en haute montagne, diminué par la maladie et n’étant pas en pleine possession de mes moyens, est-ce vraiment raisonnable et sensé de m’obstiner, sachant que la suite débouche sur un no man’s land sauvage et d’autant plus hostile ? Que ferai-je si jamais une montée de fièvre m’assiège en plein effort d’ultra-endurance ? Quels sont les risques encourus et enfin, qu’ai-je donc à me prouver ? Finalement, la décision est prise au PC7, situé au kilomètre 49, autrement dit au milieu de nulle part. J’arrête à contrecœur, convaincu par la prudence de ma conduite, et conscient qu’à la persévérance, je privilégie le discernement. Cela étant, je ne ne connais pas encore les conséquences de mon abandon, à cet endroit précis.









La contre-aventure, ou le versant caché de l’UTAT
Après une bonne heure de repos sous la tente, je me renseigne sur les conditions de mon retour à Oukaïmeden et là, surprise ! Nous devons attendre jusqu’au lendemain que les coureurs soient tous passés à un PC donné, il nous faudra ensuite randonner environ 20km en zone montagneuse pour rejoindre une route carrossable, avant d’être transportés jusqu’au CAF. Pour couronner le tout, je n’ai aucun réseau téléphonique sur place, de quoi laisser mes proches qui me suivent en ligne perplexes et inquiets. Je passe 24h avec le staff médical et d’autres coureurs qui ont également mis fin à leurs péripéties, dont Omar, un des favoris ayant auparavant remporté la course. C’est une toute autre aventure qui se dessine, humaine, imprévue et atypique. Après nous être rassasiés autour d’un tajín généreusement cuisiné par le groupe de Berbères à nos côtés, nous passons la nuit sous la tente de bivouac, enveloppés de nos couvertures de survie et accotés les uns aux autres pour mieux profiter de nos chaleurs corporelles. Cette nuit-là, l’orage nous épargne.
Sur le chemin du retour, nous traversons de minuscules villages dons les habitations sont bâties à flanc de montagne. Le mode de vie des populations locales y est rudimentaire, sobre, et en osmose avec la nature. Dans cette région du Maroc, l’humain fréquente le silence et l’immensité, la vallée étant préservée du tourisme de masse. Sur un col à mi-chemin, je capte du réseau 3G, ce qui m’autorise (enfin) à donner de mes nouvelles. Progressant dans des contrées humides, nous finissons par atteindre le village de Setti-Fatma, avant de retourner par la route à Oukaïmeden
J’éprouve une terrible frustration suite à cet échec, le plus difficile à digérer étant d’avoir dû abandonner la course alors que physiquement, je jouissais d’un niveau de forme rarement atteint. Certes, ma santé a primé dans le dénouement, mais l’amertume de l’inachevé marque mon séjour. Et de ces terres inconquises, je garde précieusement l’appel inassouvi. Toute expérience délivre un sens, quand bien même s’évertue-t-on à vouloir lui en donner un. De cet insuccès, ô combien fut-ce une mauvaise fortune, je ne ferai pas l’éloge d’un énième apprentissage. Aussi, puisque j’avais désigné cet « ultra » comme un clap de fin, symbole d’un aboutissement, il me semble que le destin en a voulu autrement, et que manifestement, il ne fait de ma capitulation qu’une vulgaire parenthèse, un cadratin sans influence, dans la perspective d’une histoire à faire perdurer. Serait-il possible qu’en dépit de mes croyances, je n’aie pas encore découvert ce à quoi j’aspirais ? N’ai-je pas encore dit mon dernier mot ? L’hiver canadien sera mon refuge un temps, mais j’ai l’intime conviction qu’il subsiste un dessein à accomplir.